 |
|
REFLEXIONS SUR BAREBACK |
|
Article proposé par le Groupe de recherche de Daniel Welzer-Lang Jean-Yves Le Talec & Daniel Welzer-Lang (1) Equipe Simone-Sagesse, Savoir, genre et rapports sociaux de sexe, université de Toulouse-Le Mirail. |
|
Pratiquer le bareback, c'est choisir de
baiser sans capote, délibérément (2). L'expression signifie « monter
à cru » (bareback horseriding). Elle est apparue dans le milieu
gai vers 1995, aux Etats-Unis. Toutefois, ce type de pratiques sexuelles
volontairement non protégées existe sans doute depuis le début de
l’épidémie de VIH-sida, comme l’ont montré diverses enquêtes épidémiologiques
(3). C’est en 1995 qu’apparaît cette revendication. Scott O’Hara, écrivain et acteur porno écrit dans la revue Steam : « J’en ai marre d’utiliser des capotes, je ne le ferai plus… » (cité par Scarce, 1999). D’autres acteurs pornos ont fait des déclarations semblables, comme Aiden Shaw, qui déclare dans Têtu : « Je ne peux pas imaginer avoir une vie sexuelle safe. Je suis le genre de personne qui prend des drogues, qui aime prendre des risques, et le sexe non protégé en fait partie. C’est ce que je préfère. […] Ce n’est pas que je n’aime pas les capotes, c’est juste un bout de caoutchouc, mais la différence entre baiser sans et avec est vraiment immense. Et prétendre depuis des années qu’il n’y a pas de différence est une connerie. » (Easterman-Ulmann, 2000 : 30). Le bareback s’est développé aux Etats-Unis et en Europe sous la forme de réseaux, essentiellement par le biais d’Internet : sites spécialisés, petites annonces, agendas de soirées. Il existe un langage et des codes propres au bareback.
De nombreux débats ont agité la communauté gaie outre-atlantique à
propos du barebacking. On peut en résumer la teneur selon différentes
approches : La crainte d’un regain de rigueur morale aux Etats-Unis, qui conduit à désigner, stigmatiser et rejeter les pratiques sexuelles qui s’écartent de la norme, a suscité un vif débat sur les rapports entre liberté individuelle et sexualité.
Le bareback s’est trouvé placé au centre
de ce débat et sa médiatisation visait à contrer le développement de
cette croisade morale (sex panic). Eric Rofes souligne que le phénomène
de Sex Panic repose sur « des formes de persécutions permanentes
(comme des mesures punitives ou de disgrâce) et un puissant courant
culturel s’appuyant sur la désignation et la honte, visant à réduire
au silence toute opposition » (Rofes, 1997). Placer le bareback
dans l’espace public, c’est une manière de résister à cette
injonction de silence. L’émergence d’un courant communautaire de barebackers a semé le trouble au sein des mouvements gais assimilationnistes, majoritaires aux Etats-Unis, en s’inscrivant en dehors d’une gestion sociale de la sexualité (reconnaissance du couple homosexuel) et en prônant une plus grande liberté sexuelle.
De plus, le bareback vient perturber
l’image, interne et externe, que la communauté gaie cherche à donner
d’elle-même : « nous nous sommes accoutumés au fait
d’attendre des pédés qu’ils gardent le silence sur la profonde
divergence qui existe entre la manière dont la sexualité des hommes
gais est publiquement représentée par les organisations de lutte
contre le sida et ce que nous savons sur ce qui se passe en réalité
dans les communautés gaies à travers le pays » (Rofes, 1998). Le terme de bareback n’est pas neutre ; il évoque implicitement la séropositivité et le risque de (sur)contamination. Pour le Dr Gregory Carson, psychiatre, ces groupes de barebackers « ne sont pas constitués d’hommes naïfs qui ont oublié les ravages du VIH dans leur propre communauté, mais plutôt d’hommes séropositifs ou assumant le risque de le devenir » (Carson, 1998). Michael Scarce ajoute que l’appréciation du bareback se double d’un jugement moral, en fonction du statut des barebackers : « Si la pratique du barebacking entre séropos suscite un froncement de sourcil, il n'en va pas de même si les partenaires sont séro-discordants. On n'hésite pas alors à employer des mots comme "meurtre" ou "suicide", ce qui explique aussi qu'un séropositif actif sera jugé plus "coupable " qu'un séropo passif. » En revanche, la notion de bareback ne semble pas inclure les partenaires réguliers, séronégatifs qui choisissent de ne pas utiliser de préservatifs, que la relation soit exclusive ou « ouverte » (dans ce dernier cas, chaque partenaires se protège lors de ses rencontres occasionnelles). Comme le souligne, avec peut-être un brin d’humour, Rick Sowadsky, coordinateur de la ligne d’écoute VIH-sida de l’Etat du Névada, « Si les deux partenaires ne sont infectés ni par le VIH, ni par aucune autre MST, le barebacking est 100% sûr du point de vue des maladies infectieuses. Dans ce cas, il tombe dans la catégorie du “safe sex“ » (Sowadsky, 1999).
Aborder le bareback revient donc nécessairement à sortir du silence
qui entoure la sexualité des personnes séropositives. Il ne semble pas y avoir eu initialement de relation de cause à effet entre l’émergence du bareback et l’arrivée des antiprotéases et des trithérapies : les deux phénomènes sont en effet contemporains (1995). Aujourd’hui, l’amélioration des résultats thérapeutiques et la possibilité de recourir à des traitements « post-exposition » crée un contexte qui peut expliquer que certains gais choisissent d’abandonner le préservatif.
Cependant, certaines questions relatives à la connaissance des risques
restent toujours très floues ou controversées : le risque lié à
la fellation, le risque de surcontamination ou de combinaison entre différentes
souches de VIH dont certaines sont résistantes aux antiviraux, le
risque de transmission du VIH lors d’une pénétration sans éjaculation,
le pouvoir contaminant du sperme d’un individu séropositif dont la
charge virale est nulle, etc. A ce propos, Michael Scarce observe que
« le discours univoque de « l'establishment » antisida [aux
Etats-Unis], qui classe les pratiques sexuelles en deux catégories
seulement, “haut risque“ et “risque faible ou nul“, laisse de
nombreux gays, dont les pratiques se situent entre ces deux extrêmes,
sans aucun soutien dans leurs attitudes sexuelles. » L’érotisation du risque et du virus a pu être constatée entre partenaires barebackers. L’intimité recherchée lors de sodomies non protégées prend une dimension allégorique de la contamination et de l’invasion virale. Le partenaire qui recherche une contamination est dit bug chaser et l’infection est dénommée « fécondation ». Le partenaire contaminant est dit gift giver et il assume la “paternité“ de la (sur)contamination. Michael Scarce conclut : « Pour ces hommes, la séroconversion est devenue un rituel d'adoption, plutôt que le fruit du hasard, formulée avec des métaphores de la grossesse ».
Quelle que soit leur perception, les barebackers doivent avoir accès à
des informations précises sur les pratiques sexuelles non protégées,
de manière à pouvoir élaborer une démarche de réduction des
risques. Mais, comme le souligne Michael Scarce, « une démarche
limitée à la seule réduction des risques ne saurait répondre à ce
qui représente peut-être le plus grand danger qu’encoure le
barebacking : l’incapacité des membres de la communauté gaie et de
ses leaders à discuter de ces questions avec une attitude compréhensive
et de respect mutuel. » (Scarce, 1999). En France, l’émergence du bareback a provoqué jusqu’à présent une « guerre de tranchée », entre défenseurs (comme Guillaune Dustan) et opposants (comme Act Up Paris), plutôt qu’un véritable débat, qui dépasserait l’alternative entre liberté individuelle et morale sexuelle (Dustan, 2000 ; Lestrade, 2000).
La publicité autour de pratiques sexuelles non protégées inquiète
pouvoirs publics, les structures de prévention et les médias grand
public (Grosjean, 2000), d’autant que l’on manque de données épidémiologiques
actualisées (Favereau, 2000). Qu’en est-il sur le plan de la
recherche ? Les dernières recherches menées en France attestent de l’existence de pratiques sexuelles délibérément non protégées, sans pour autant pouvoir mesurer l’ampleur du phénomène. Dans le milieu gai, une recherche sur l’état des lieux du dispositif de prévention à Paris présente le témoignage d’hommes gais pratiquant le bareback. De plus, l’étude d’un certain nombre de médias gais – presse, audiotel, minitel, Internet – confirme la présence du bareback dans l’espace culturel, sous forme, par exemple, d’annonces de rencontre (Le Talec, 2000). Un travail de recherche en cours sur « Les bisexuels masculins et la prévention sida » met également en évidence l’adoption de pratiques sexuelles non protégées (Welzer-Lang, 1999). Dans le contexte de relations hétérosexuelles, enfin, on voit également apparaître des annonces « no kapote » (Couples contre le sida, Haute Garonne). La présence du bareback est donc aujourd’hui attestée en France. Elle concerne des personnes qui en font le choix délibéré, mais peut aussi attirer et séduire des hommes et des femmes mal informé-e-s ou prêt-e-s à renoncer au préservatif pour concrétiser une rencontre. On ne peut limiter les débats sur le barebacking aux débats entre adultes consentants, libres de leurs choix sexuels. Ainsi, il faut mettre en parallèles les constats d'isolement social, de misère affective, d'homophobie vécue et intériorisée que fait la ligne Azur, et le risque de contamination par des jeunes homosexuels ou bisexuels cherchant dans les backrooms une sexualité à tous prix. Tout en rappelant, comme d'autres chercheurs ont pu le faire, que la question du risque n'est pas liée à la nature récréative de la sexualité, aux lieux d'exercice de cette sexualité, ni au nombre de partenaires (Mendes-Leite, 1995), force est de constater dans nos recherches respectives avec les gais, les bis ou les hétérosexuel-le-s, que l'analyse de la négociation du risque doit aussi prendre en compte les états seconds liés au désirs, aux drogues. De plus, souvent contraintes à des formes de sexualités multiples, les femmes ne sont pas toujours aptes à négocier les modes de prévention (Welzer-Lang, 1998).
Le défaut d’informations épidémiologiques et d’enquêtes approfondies sur les pratiques sexuelles ne permettent pas de quantifier l’impact du barebacking à l’heure actuelle. On ignore en particulier le profil des nouvelles contaminations, bien que l’on sache que le recours aux traitements « post-exposition » a doublé au cours des six derniers mois dans certains centres de prescription (Le Talec, 2000).
Aujourd'hui l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS), Ensemble
contre le sida (Sidaction), la Direction générale de la santé (DGS)
et les DDASS, subventionnent encore quelques recherches sur les sexualités,
mais elles sont peu nombreuses et souffrent d’un défaut de stratégie
et de coordination. De plus, différemment du début des études sur le
sida, les exigences (légitimes) de scientificité, et — ce qui est
moins compréhensible — la non prise en compte de la dynamique de
constitution d'un corps de jeunes chercheur-e-s, autrement dit le
soutien à des démarches naisssantes, souvent isolées dans l'Université
française, aboutit au non renouvellement du corps des spécialistes
financés, et par ce fait, la non-intégration de démarches nouvelles
dans les recherches. |
|
Bibliographie :
|
|
Notes :
|
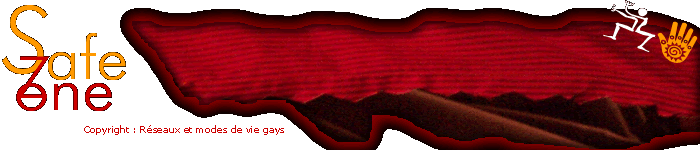 |